Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) touche un nombre croissant de personnes en France et dans le monde. La question de la reconnaissance de ce trouble comme un handicap se pose avec acuité. Cette problématique est complexe car elle implique des dimensions médicales, sociales et juridiques. Afin d’y voir plus clair, il est primordial de comprendre la nature du TDAH. Mais aussi sa définition par les professionnels de santé. Et enfin les situations dans lesquelles il peut ouvrir droit à une reconnaissance de handicap. Le TDAH est-il un handicap ? La réponse est oui.
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité c’est quoi ?
Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui peut se manifester dès l’enfance. Il se caractérise par des difficultés d’attention, une impulsivité prononcée. Et, chez certains individus, une hyperactivité motrice. Il est important de noter que ces symptômes présentent une grande variabilité interindividuelle. Tant en termes d’intensité que de manifestations. On peut observer chez une personne atteinte :
- une instabilité de l’attention marquée
- une tendance à la dispersion
- un besoin constant de stimulation
- ou encore une difficulté à réguler ses émotions
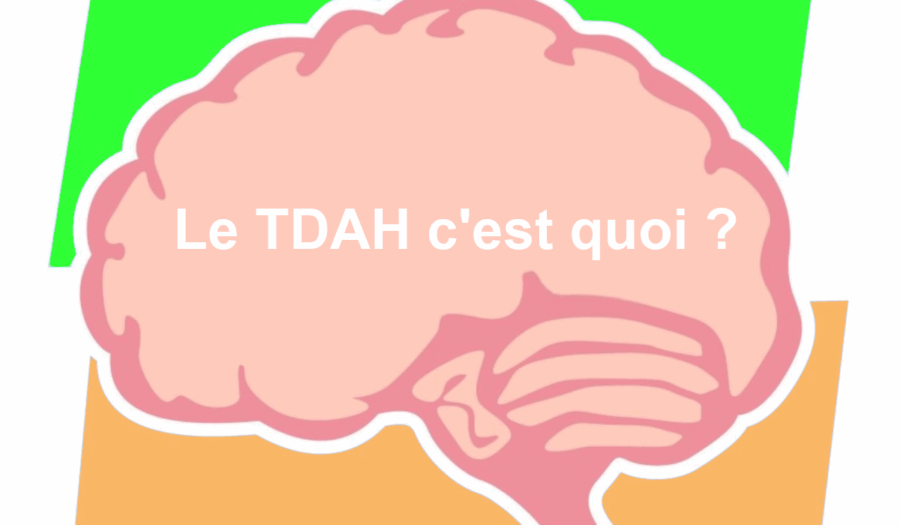
Ces manifestations ne sont pas le fruit d’un simple manque de volonté. Elles s’expliquent par un fonctionnement cérébral particulier, notamment une altération de certains circuits neuronaux impliqués dans la régulation de l’attention et de l’inhibition comportementale. Ainsi, le TDAH ne peut être réduit à une question d’éducation ou de discipline. Il s’agit d’un trouble reconnu par les classifications médicales internationales, telles que le DSM-5 et la CIM-11.
Chez l’enfant, les symptômes entraînent fréquemment des difficultés scolaires, des conflits relationnels et un risque accru de faible estime de soi. Chez l’adulte, ils se traduisent par des problèmes d’organisation, une tendance à la procrastination, des oublis fréquents et parfois un sentiment de découragement face aux exigences professionnelles et familiales. La persistance des symptômes à l’âge adulte est aujourd’hui mieux documentée. On estime qu’environ 60 % des enfants diagnostiqués continueront de présenter des manifestations du trouble à l’âge adulte. Mais alors le TDAH est-il un handicap ?
Le TDAH est-il juridiquement reconnu comme un handicap ?
La reconnaissance du TDAH comme un handicap repose sur plusieurs facteurs : la sévérité des troubles, leur impact sur l’autonomie et la capacité à mener une vie normale. Mais aussi le cadre législatif du pays de résidence. En France, le Code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne. Cela en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une fonction physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique.
Le TDAH, en tant que trouble neurodéveloppemental, s’inscrit dans la catégorie des altérations cognitives et psychiques. Cependant, sa reconnaissance en tant que handicap n’est pas automatique. Elle nécessite une évaluation individuelle par des professionnels de santé et des équipes pluridisciplinaires. Ces évaluations se fondent sur la mesure de l’impact réel du trouble sur la vie quotidienne et l’autonomie.

En pratique, il vous incombe de constituer un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Le dossier MDPH TDAH doit comporter le formulaire de demande MDPH, un certificat médical détaillé et les justificatifs d’identité et de domicile. Sur cette base, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH est ensuite chargée d’examiner le dossier. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut accorder par la suite différents types de reconnaissance. Selon la gravité du handicap et ses répercussions.
La jurisprudence française reconnaît que le TDAH peut constituer un handicap lorsqu’il a un retentissement majeur et durable sur l’autonomie ou la capacité de travail. Cette approche individualisée explique pourquoi certaines personnes obtiennent une reconnaissance et d’autres non. Il ne suffit donc pas d’un diagnostic médical : c’est la combinaison du diagnostic et de l’évaluation fonctionnelle qui fonde la décision.
Quels sont vos droits suite à la reconnaissance du TDAH ?
Une fois votre TDAH reconnu comme handicap, plusieurs droits et mesures de soutien s’ouvrent à vous. Vous pouvez bénéficier d’aménagements dans votre environnement de travail : temps de pause supplémentaires, adaptation du poste de travail, horaires plus flexibles, accompagnement par un référent handicap. Ces mesures visent à compenser les difficultés d’attention et d’organisation.
En milieu scolaire, la reconnaissance du handicap permet la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ces dispositifs prévoient des aménagements pédagogiques adaptés, tels que des temps majorés aux examens, des supports visuels simplifiés ou l’autorisation d’utiliser des outils numériques. Pour les étudiants, le statut d’étudiant en situation de handicap facilite également l’accès à des aides financières et à des services d’accompagnement spécifiques.
Sur le plan financier, vous pouvez solliciter l’AAH si votre autonomie est fortement réduite. Cette allocation a pour objectif de garantir un revenu minimal. La PCH, quant à elle, finance certaines aides humaines ou techniques nécessaires à la compensation de la perte d’autonomie. Cependant, ces prestations sont attribuées après une évaluation précise de la situation et ne concernent que les formes sévères du TDAH.
La reconnaissance du handicap confère également une protection juridique. Elle vous protège contre la discrimination fondée sur votre trouble et impose à l’employeur une obligation d’adaptation raisonnable. La loi du 11 février 2005 en France encadre ces droits et établit les principes de l’égalité des chances et de l’inclusion sociale.
Enfin, la reconnaissance du TDAH comme handicap peut avoir un impact psychologique significatif. L’obtention d’une validation officielle de vos difficultés peut engendrer un sentiment de soulagement. Cette reconnaissance facilite l’accès à une prise en charge pluridisciplinaire, impliquant médecins, psychologues et ergothérapeutes. Elle permet également d’instaurer un dialogue plus constructif avec les proches, les collègues et les employeurs. Ceci en clarifiant les besoins spécifiques et en atténuant certains préjugés. Besoin d’aide, n’hésitez pas à faire appel à une association.
